Photographe, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.
Résultats de la recherche : Île-de-France 2757 résultats
Dossier
Dossier IA93000596
| Réalisé
par
-
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Chambrion Matthieu
Chambrion Matthieu
Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Dossier
Dossier IA93001106
| Réalisé
par
-
Stade de France
Guilmeau Stéphanie
Guilmeau Stéphanie
Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Dossier
Dossier IA93001097
| Réalisé
par
-
Centre sportif municipal de l'île des Vannes
Guilmeau Stéphanie
Guilmeau Stéphanie
Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Notice d'illustration
IVR11_20049300418XA
|
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Vue du portail monumental.
Notice d'illustration
IVR11_20049300422XA
|
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Façade sur la rue Romain-Rolland.
Notice d'illustration
IVR11_20059300668NUCA
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Mandat de la société Ohresser, avant 1934 (collection particulière).
Notice d'illustration
IVR11_20059300145NUCB
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Intérieur de l'usine de confection Ohresser, v. 1910-1920 (collection Jean Huret).
Notice d'illustration
IVR11_20049300426XA
|
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Détail de la façade sur la rue Romain-Rolland : corniche et chaînage de brique.
Notice d'illustration
IVR11_20059300669NUCA
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Vue perspective de l'usine Ohresser. Mandat de la société, détail, avant 1934 (collection particulière).
Notice d'illustration
IVR11_20049300420XA
|
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Vue d'ensemble depuis l'angle de la rue du Centre et de la rue Romain-Rolland.
Notice d'illustration
IVR11_20059300378XA
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Logotype de la société JO-CA (Ville des Lilas, dossier Permis de construire 1948-1).
Notice d'illustration
IVR11_20059300377XA
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
Plan accompagnant une demande de permis de construire : "Agrandissement chaufferie" (élévation et coupes), 1948. (Ville des Lilas, dossier Permis de construire 1948-1).
Notice d'illustration
IVR11_20049300424XA
|
Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements
La façade sur la rue Romain-Rolland associe brique et meulière rocaillée. Le chaînage est surmonté d'un fleuron en céramique et de deux consoles trigliphées.
Dossier
Dossier IA00141306
| Réalisé
par
-
regard photographique sur les paysages de la Plaine de France.
Notice d'illustration
IVR11_20219300690NUC4A
Centre sportif municipal de l'île des Vannes
Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Détail d'une entrée.
Notice d'illustration
IVR11_20219300685NUC4A
Centre sportif municipal de l'île des Vannes
Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Vue générale extérieure.
Notice d'illustration
IVR11_20219300676NUC4A
Centre sportif municipal de l'île des Vannes
Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Détail de l'élévation principale.
Notice d'illustration
IVR11_20219300693NUC4A
Centre sportif municipal de l'île des Vannes
Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes avant travaux. Vue extérieure large.
Notice d'illustration
IVR11_20219300639NUC4A
Centre sportif municipal de l'île des Vannes
Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Vue intérieure, dans la longueur.






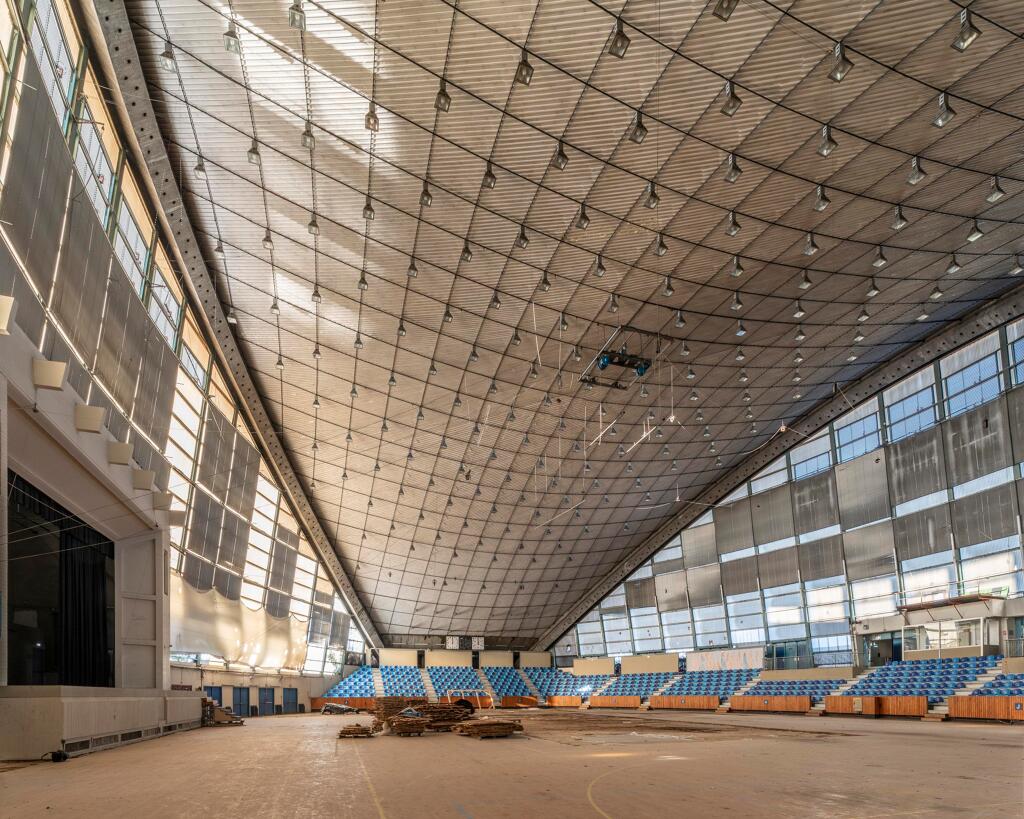

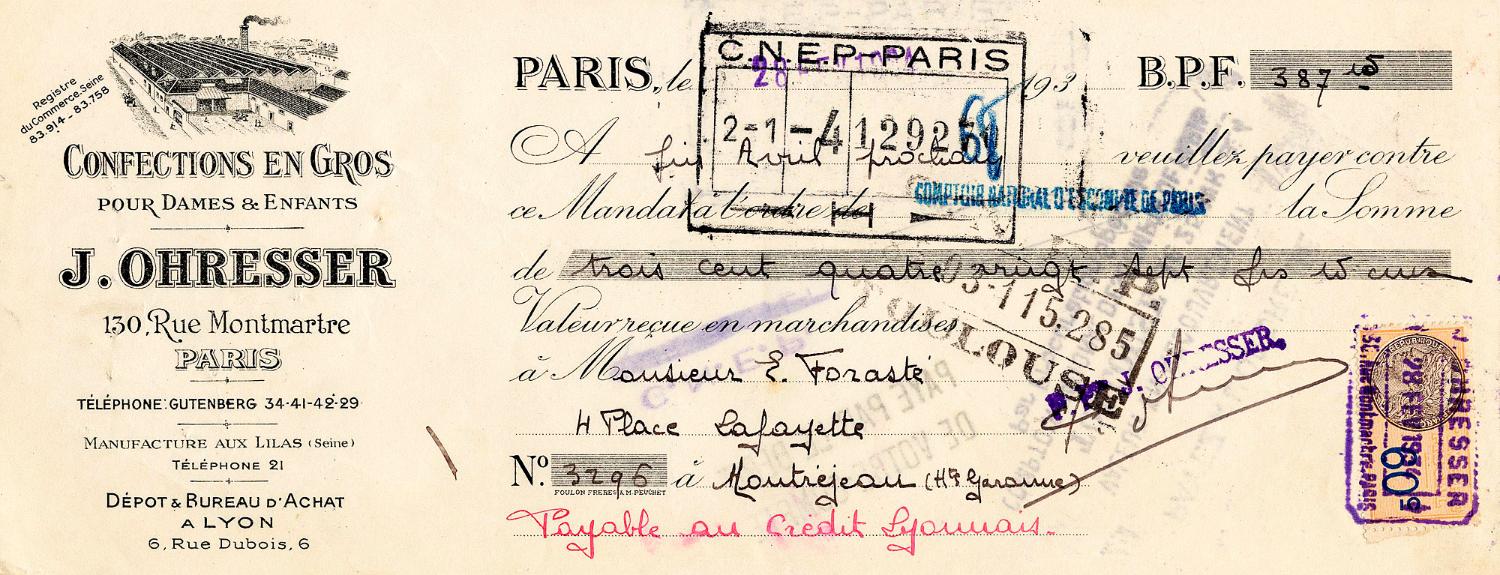
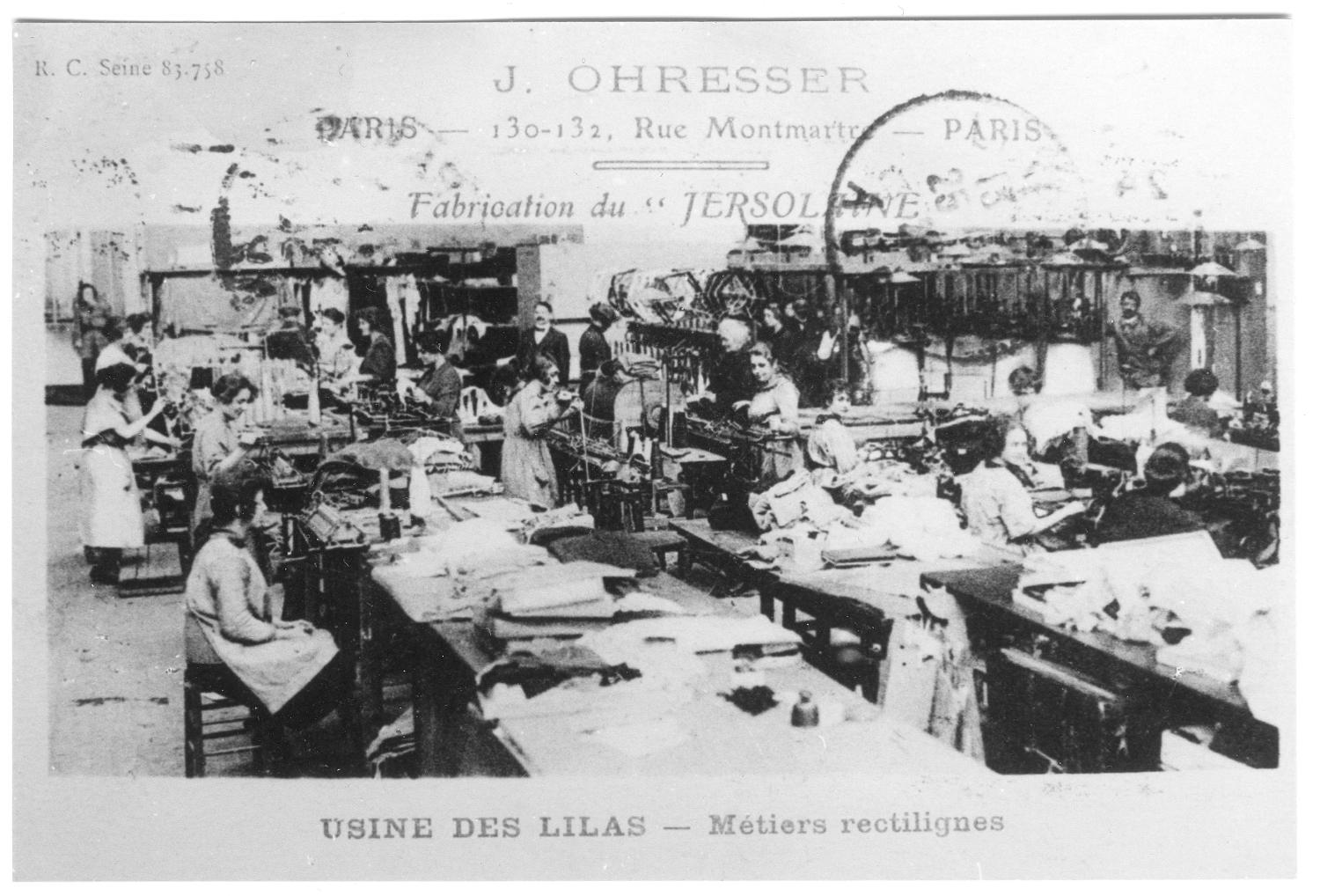

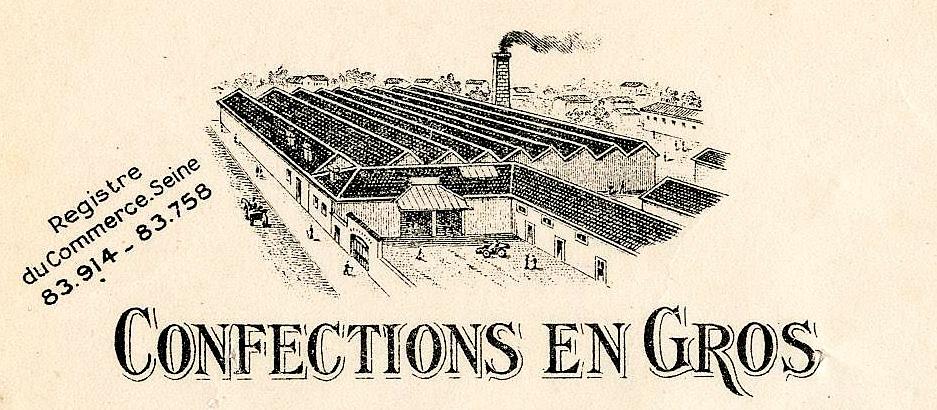

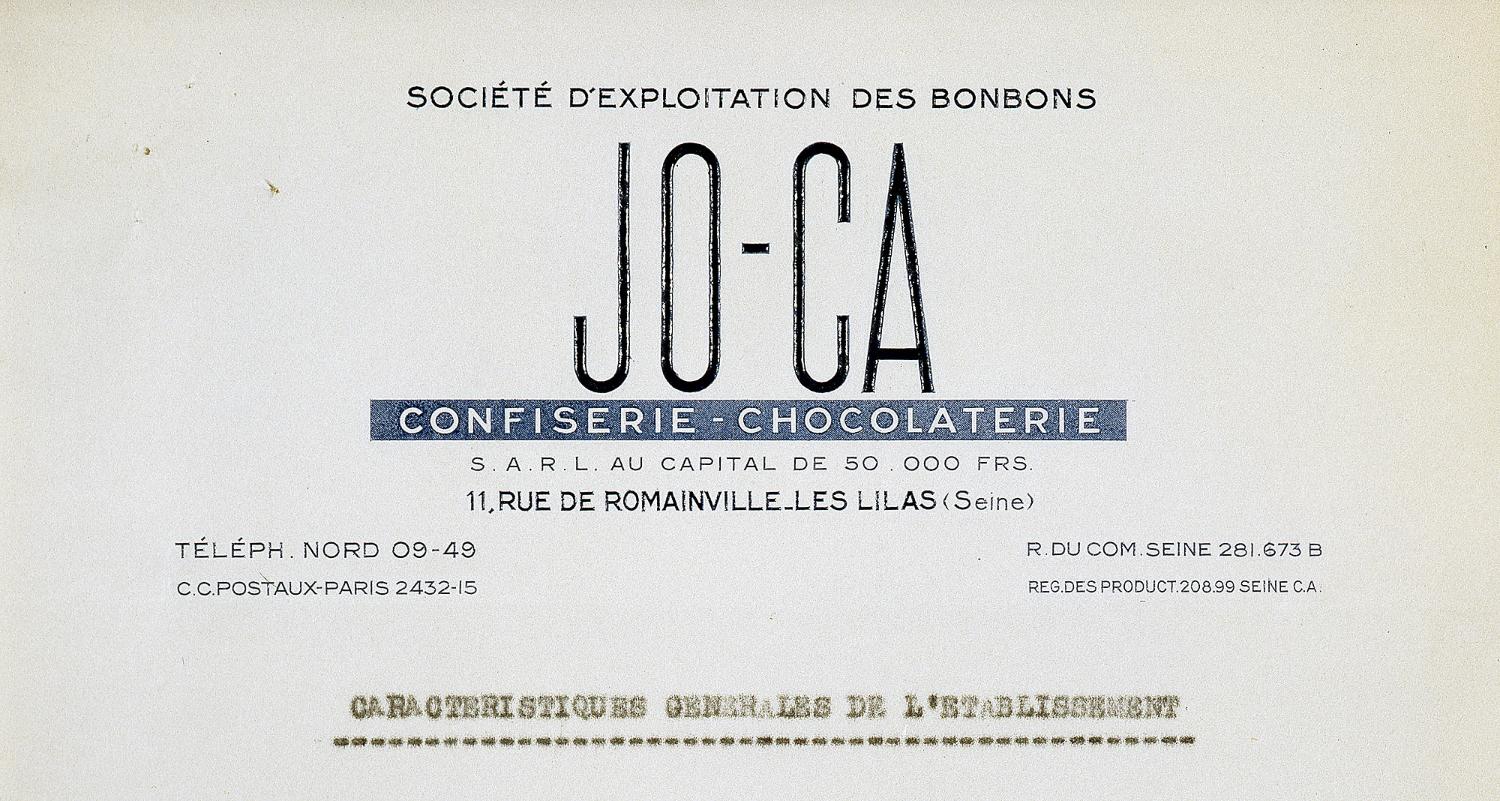
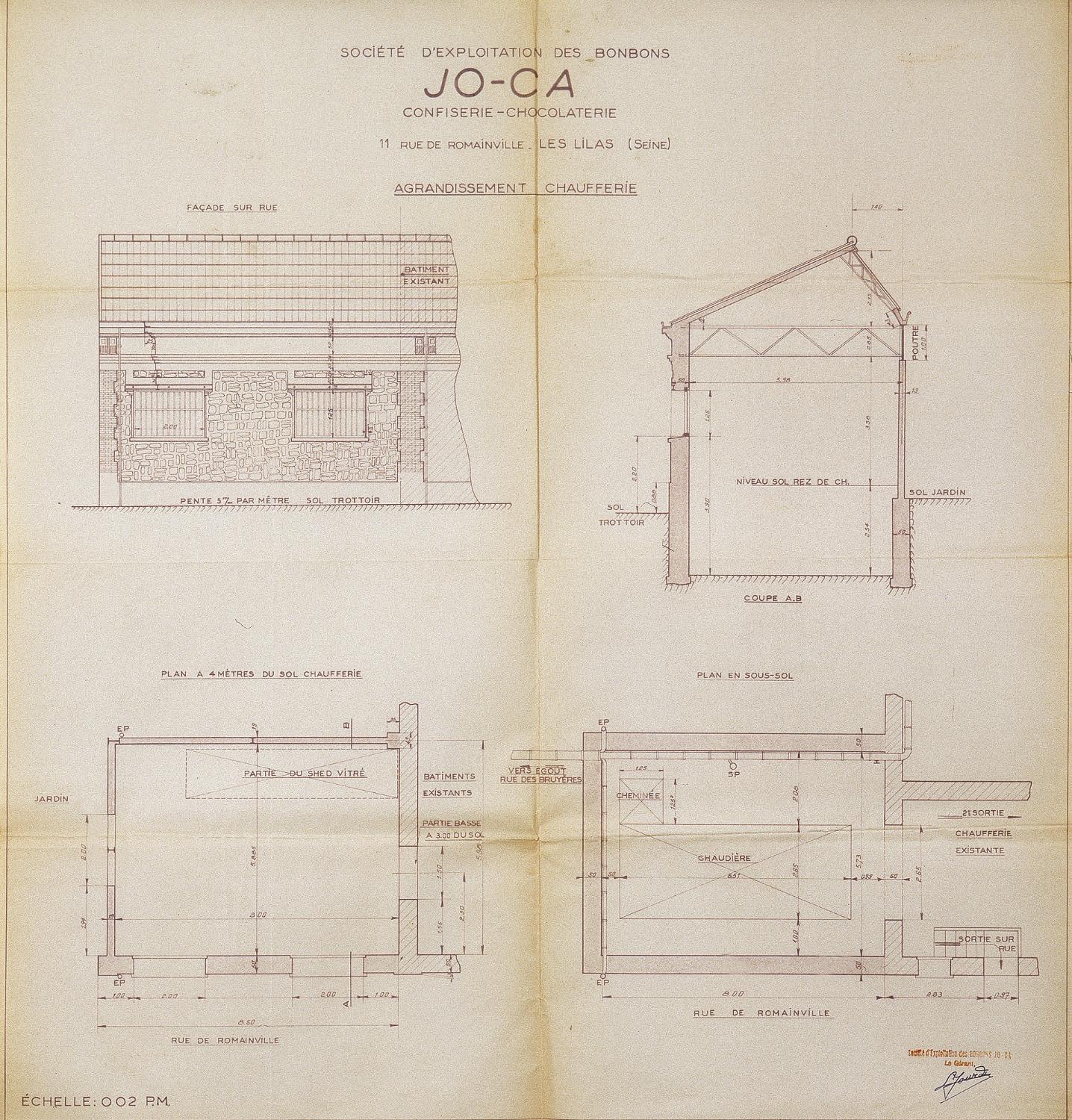

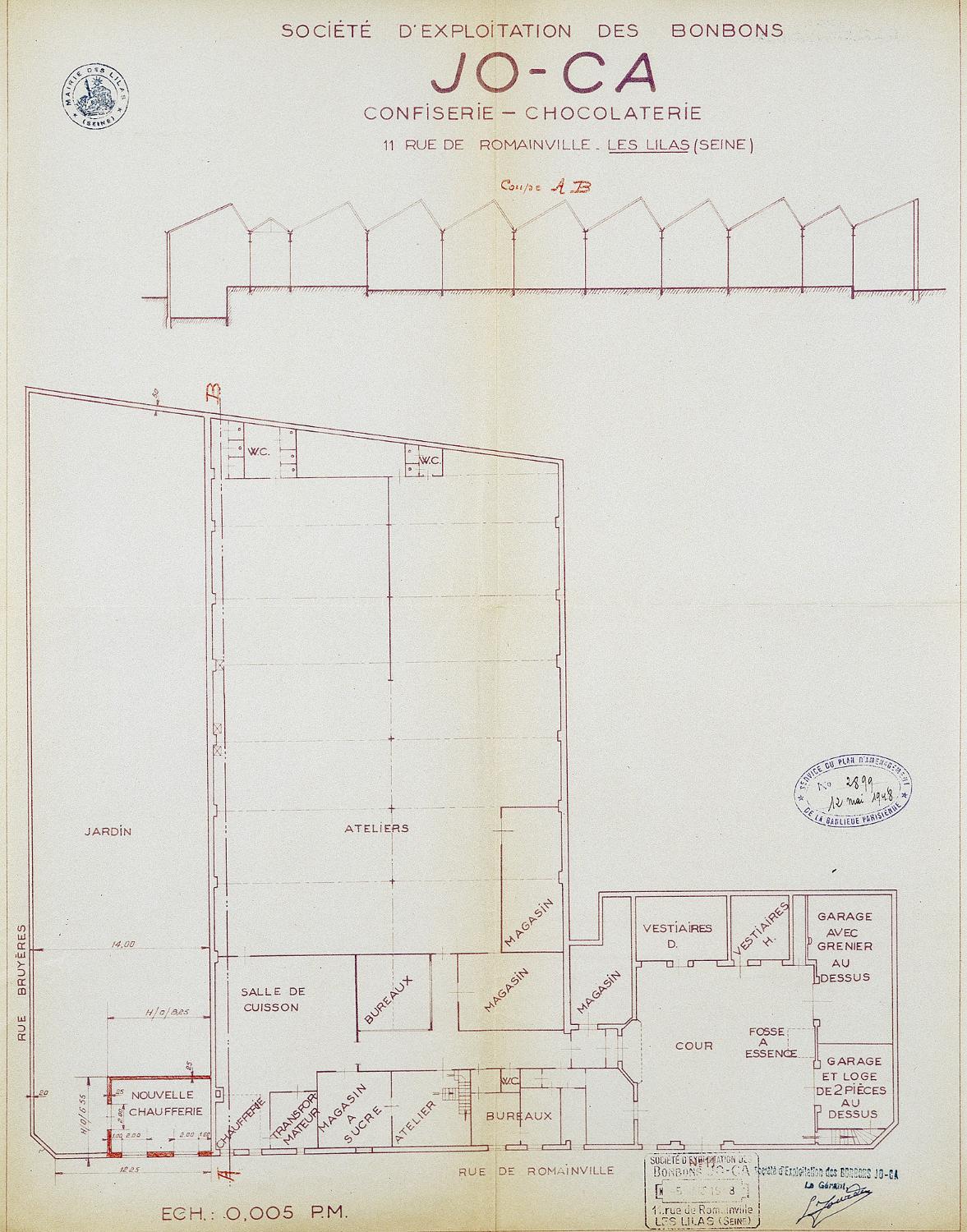




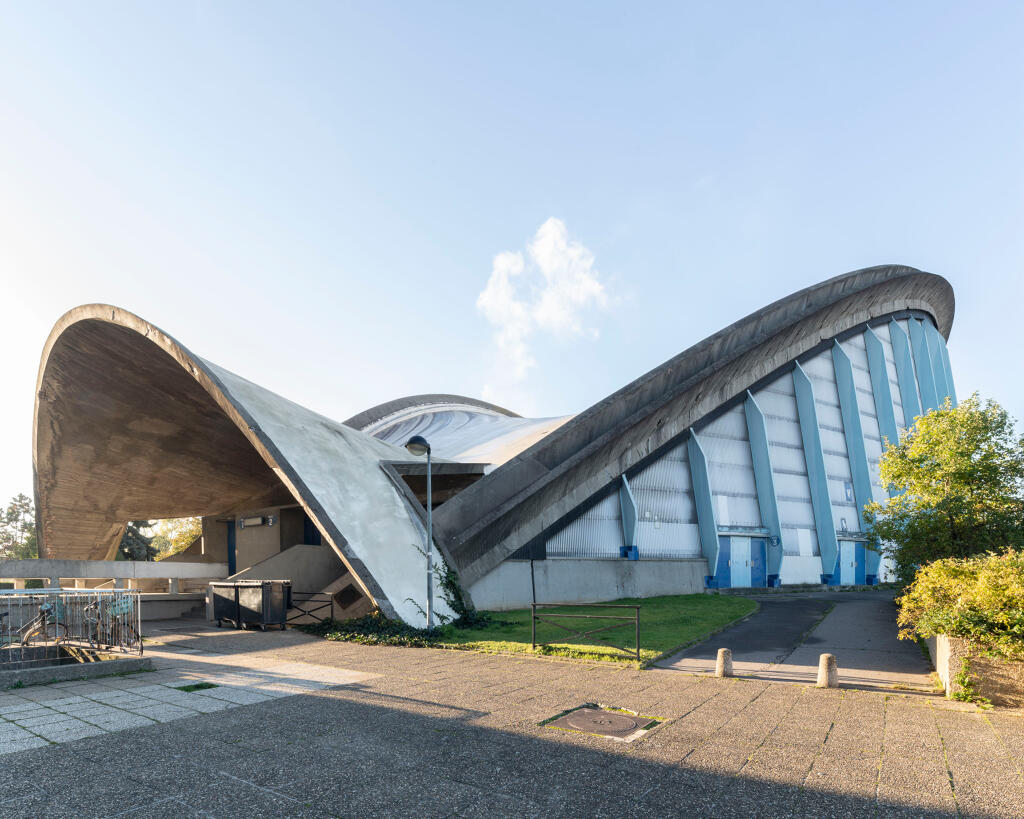

Conservateur en chef du patrimoine, en charge du patrimoine industriel, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.